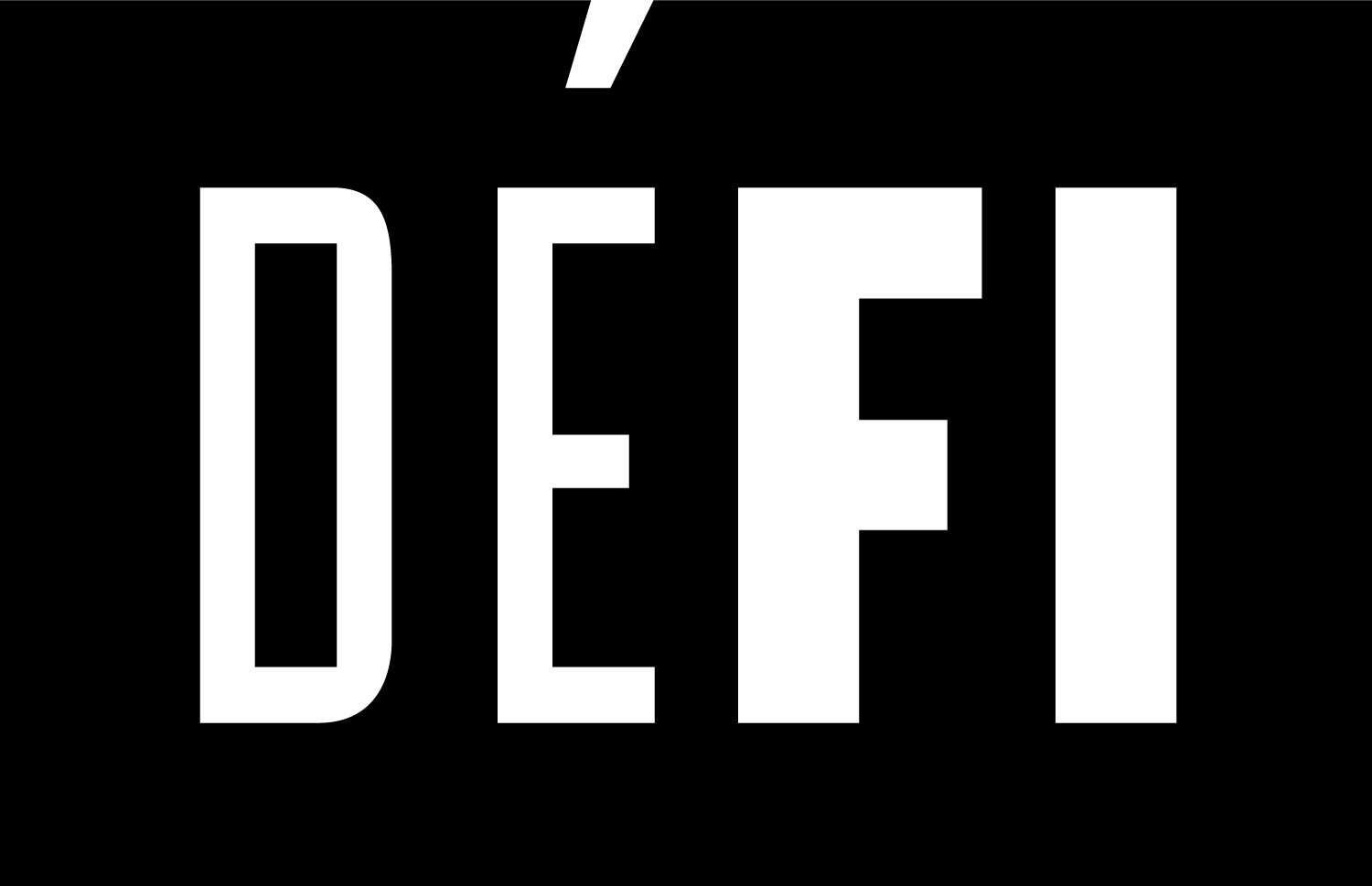Fin septembre 2023, le soleil brille sur la Côte d’Opale. Les fortes températures à cette époque de l’année sont un signe visible du changement climatique. Bien que très inquiets pour l’avenir, mon épouse et moi profitons de l’instant présent. Nous parcourons depuis quelques jours cette belle région alternant balades, baignades et lectures.
Mais un beau matin, je commence à ressentir une douleur au bas du dos. Certes ce n’est pas la première fois et à plusieurs reprises je me suis retrouvé au service des urgences à Fécamp pour une vilaine lombalgie. Il faut donc que je me ménage. Une courte balade autour du magnifique Cap Blanc Nez. Mais au fil de la matinée, la douleur augmente. Pour l’après midi, ce sera repos et lecture, allongé pendant plusieurs heures. On envisage pour le lendemain de consulter un médecin. Mais en début de soirée, j’ai de plus en plus mal. Mon dos est bloqué. Au moindre mouvement, la douleur devient très aigüe et mon épouse appelle le 15 pour un avis médical. Le médecin régulateur envoie une ambulance pour un transfert au service des urgences du CHAM. Nous sommes dans le Pas-de-Calais et j’apprendrai plus tard qu’il s’agit du Centre hospitalier de l’arrondissement de Montreuil-sur-Mer.
Le transfert dans l’ambulance est un véritable supplice. Puis me voici sur un autre brancard au service des urgences. En moins d’une heure, un interne m’ausculte. Impossible de m’asseoir. Au moindre mouvement, je ne peux retenir un cri. Une lombalgie aigüe. Dès minuit ce sera du Tramadol en perfusion (un antalgique qui appartient à la classe des opioïdes comme la morphine). Très efficace en effet. Je suis sur un nuage. Je flotte. Je suis dans le gaz…
Une heure et demie plus tard, le médecin m’ausculte de nouveau et me demande de m’asseoir. Je doute fortement de cette possibilité mais très lentement avec la plus grande précaution, je réussis. Il me demande de me lever. Je doute de nouveau mais j’obtempère et je fais le tour du lit. C’est le flou absolument dans ma tête. L’antalgique fait de l’effet et la douleur est nettement moins forte. C’est alors que l’interne, sur un ton péremptoire lâche un « vous marchez, vous êtes sortant ! ». Il est deux heures du matin, le médecin m’informe qu’il n’y a pas de service d’ambulances la nuit et que je trouverai à l’accueil une liste de taxis à appeler. Il me prévient que les frais de taxi seront à ma charge et que je ne pourrai pas me faire rembourser. Etant toujours dans un état second, j’essaie de négocier pour une sortie en début de matinée et une fin de nuit sur ce brancard, éventuellement dans le couloir. Pas question ! Je dois libérer la place. Le médecin insiste : même en début de matinée le taxi sera à ma charge. Là n’est pas le problème. Il faut impérativement que je libère la place. Une infirmière me retire la perfusion. Le médecin me tend une ordonnance et quelques cachets à prendre en attendant le passage à la pharmacie.
À un train de sénateur, je rejoins l’accueil. Au passage une infirmière me demande si je n’ai pas oublié mes chaussures. Et non ! Je suis arrivé pieds nus en pyjama et je repars de même. Je consulte la longue liste des taxis et très gentiment, la réceptionniste me propose d’essayer de les joindre. Elle me prévient que vers minuit un taxi est venu mais elle doute fortement qu’il accepte de venir à deux heures du matin. Après quatre appels et autant de messages laissés sur des répondeurs, elle renonce à appeler un taxi d’Abbeville distant de 50 km de l’hôpital ! Ce risquerait de me coûter très cher, dit-elle.
Je patiente donc assis dans le couloir et vers trois heures et demie, une infirmière s’étonne de me voir encore ici et comprenant qu’aucun taxi ne viendra, se propose de me trouver un brancard et un local. Je vais passer le reste de la nuit dans une pièce encombrée de matériels, dans le noir, sans possibilité d’allumer la lumière ni d’appeler qui que ce soit.
A six heure dix, réveil en fanfare. La lumière s’allume et un cerbère, une infirmière, me crie dessus : « Avez-vous appelé pour que l’on vienne vous chercher ? Il ne faut pas rester là ! ». La douleur étant revenue, je demande un verre d’eau pour prendre l’antalgique que l’on m’avait donné. Sa seule réponse ; « Vous n’avez pas répondu à ma question. Avez-vous appelé pour que l’on vienne vous chercher ? Il ne faut pas rester là ».
Je me lève et retourne à l’accueil. Quatre nouveaux appels pour des taxis. Tous sur répondeur. Et ce n’est que vers huit heures que l’on viendra me chercher.
Pendant ces quelques heures d’attente, je suis seul, assis dans le couloir, face à l’accueil. Plus d’une soixantaine de membres du personnel qui quittent ou prennent leur service vont passer devant moi. Deux ou trois personnes seulement m’adresseront un bonjour, un sourire. Les autres, celles et ceux qui à 20 h en temps de pandémie on applaudissait du haut de nos balcons, passeront en détournant la tête, refusant de voir ce patient qu’on abandonne. C’est le moment le plus douloureux que je retiens de cette mauvaise expérience. Mon cas n’était pas grave mais l’indifférence absolue, un certain manque de considération de la part du personnel de cet hôpital m’ont touché.
La gestion comptable que l’on a imposée depuis des années a fait incontestablement souffrir l’ensemble du personnel soignant. Espérons que le rendement à tout prix n’est pas en train de déshumaniser l’hôpital.
Jean-Luc Dron